Littérature française
David Fauquemberg
Cante jondo
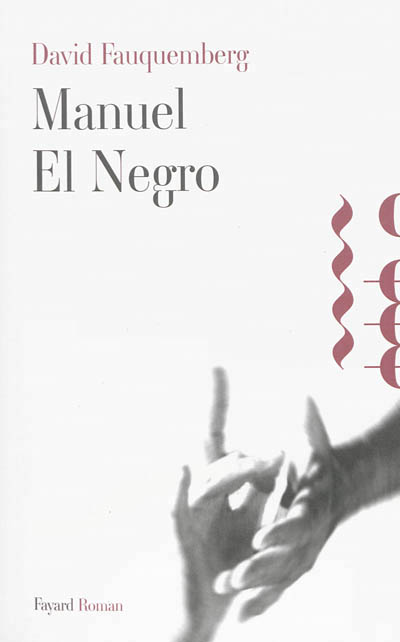
-
David Fauquemberg
Fayard
21/08/2013
368 p., 20 €
-
L'entretien par Marie Hirigoyen
Librairie Hirigoyen (Bayonne) -
Lu & conseillé par
4 libraire(s)- Laurence Behocaray de I.U.T. Carrières sociales - Site Jean Luthier - Université de Tours (Tours Cedex)
- Marie Hirigoyen de Hirigoyen (Bayonne)
- Wilfrid Sejeau
- Romain Vachoux de du Tramway (Lyon)

L'entretien par Marie Hirigoyen
Librairie Hirigoyen (Bayonne)
David Fauquemberg est un nomade attentif au chant du monde. À ce titre, il nous plonge au cœur de la tradition flamenca. Comme personne, il sait faire claquer en mesure les mots qui disent la souffrance et la joie. À la vie à la mort.
« Un ami, disait le poète, c’est soi-même sous un autre cuir ». Vivant depuis l’enfance dans une petite ville d’Andalousie, le destin de Melchior de la Pena est lié à celui de Manuel El Negro. Le guitariste de l’ombre dit toute une vie passée « le front courbé au-dessus des cordes », à servir l’art du flamboyant cantaor. Il se souvient des nuits ferventes du quartier gitan où retentit l’étourdissante buleria, du chant né de la terre écrasée de soleil et de la gloire éphémère des grands festivals internationaux. Leur amitié, comme la musique, se nourrit du son en lutte farouche avec le rythme, entre fusion mystique et échappées insolentes. Et toujours résonnent les palmas, « ce crépitement syncopé […] qui vous ferait danser un mort ». Ainsi se révèle la singularité d’une culture, d’une façon d’être au monde, celle d’un peuple qui sublime dans le chant et la danse la violence de vivre. Avec la noblesse et la grâce des princes.
Page — Vous êtes un voyageur de l’immersion. Dans « Nullarbor », vous suiviez le chemin erratique des aborigènes d’Australie, à l’écoute de leur « chant des pistes ». Après « Mal tiempo », votre roman sur la rage de boxer à Cuba, on vous retrouve comme si vous étiez des leurs, comme si c’était votre tradition familiale, chez les Gitans d’Andalousie. Comment avez-vous réussi à faire corps à ce point avec la culture du flamenco ?
David Fauquemberg — Le flamenco est une passion depuis mon adolescence. Mais dès que l’idée d’écrire ce roman s’est imposée, il y a cinq ans, j’ai compris qu’il allait falloir m’immerger corps et biens dans ce monde-là. Ce qui m’a attiré d’abord, c’est l’intensité de cette musique, les émotions qu’elle transmet. Il me manquait ce qui fait la force du roman : les hommes comme ils vivent, leurs rêves, leurs tourments… Pendant près de trois ans, j’ai écumé les quartiers gitans d’Andalousie, les lieux flamencos, de Jerez à Séville, d’Utrera à Grenade. Des amitiés fortes se sont nouées : musiciens amateurs ou professionnels, danseurs, aficionados, tenanciers de cafés… J’ai suivi des artistes en tournée dans les minuscules peñas andalouses, vécu des fiestas familiales endiablées, des juergas sans fin, ces fêtes improvisées qui n’ont d’autre but que le chant et s’éternisent parfois trois jours et autant de nuits ! J’ai découvert une culture dont je n’imaginais pas la profondeur. Car, plus qu’une musique, le flamenco est un art de vivre, une vision du monde – le refus acharné de se laisser corrompre par l’argent, un amour absolu de la beauté et de la poésie, celle des vieux couplets anonymes, qui imprègne jusqu’aux conversations quotidiennes…
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE CET ENTRETIEN EN PAGE 54 DU N° 162 DE VOTRE REVUE PAGE DES LIBRAIRES




















